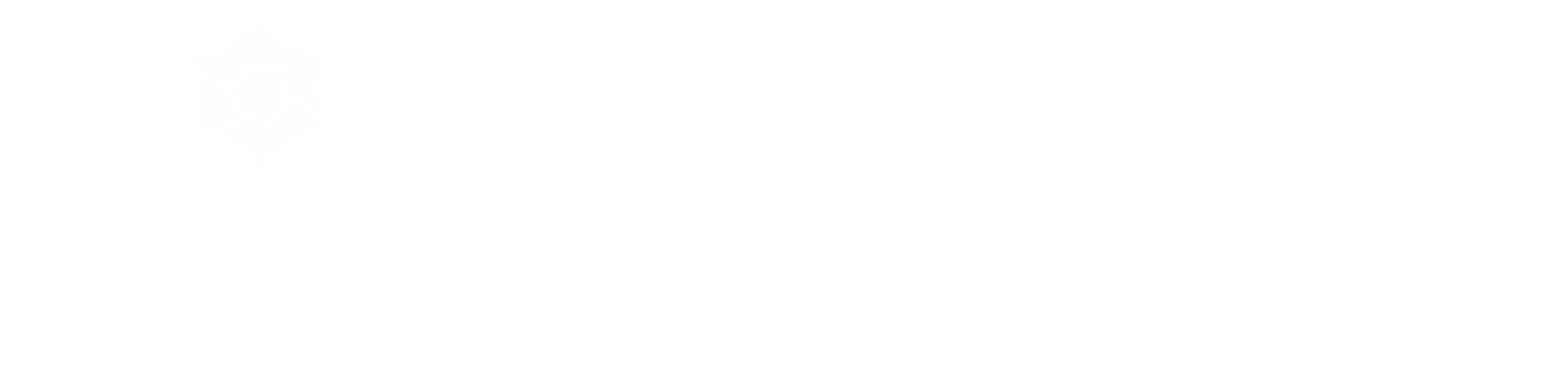◆ Valeur ajoutée, services rendus ◆
Conserver la nature rapporte économiquement bien plus que de la détruire ! Les habitats de la réserve naturelle ne sont pas seulement essentiels à la biodiversité. Ils jouent un rôle économique majeur.
Pourquoi sont-ils si précieux ? Qu’avons-nous à perdre si nous ne les protégeons pas ?
C’est ce que nous avons voulu savoir en répondant en 2023 à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par Réserves Naturelles de France. L’association, bénéficiant d’un soutien financier du Fonds Vert, a impulsée une étude pour évaluer la valeur ajoutée des réserves naturelles en Nouvelle-Aquitaine en collaboration avec Vertigo Lab, bureau d’études et de recherche en économie de l’environnement.
Retenue pour participer à ce projet avec 9 autres réserves naturelles, la réserve naturelle d’Arjuzanx a réalisé cette étude de juillet 2024 à février 2025.
Au final, l’étude a permis d’établir que les milieux naturels de la réserve naturelle valent près de 2 millions d’euros par an en services écosystémiques.
Voici quelques-uns des plus importants :
1 – régulation du climat global
Les milieux naturels ont la capacité de séquestrer des gaz à effet de serre, atténuant ainsi le changement climatique et ses effets. La séquestration carbone annuelle des milieux naturels est de 6 791 tonnes de CO2, soit l’empreinte carbone annuelle de 682 français, permettant d’éviter des coûts pour la population mondiale de l’ordre de 602 772 €/an. Les milieux les plus favorables à la séquestration sont les boisements humides, les chênaies et les forêts mixtes.
2- régulation des incendies
Les milieux naturels et l’équipe gestionnaire jouent plusieurs rôles face au risque incendie du territoire :
- lutte probable par la présence d’une mosaïque d’habitats naturels (ou « discontinuités horizontales ») et par le développement de la résilience accrue (capacité du milieu à se reconstituer) des peuplements forestiers mixtes due aux modes de gestion favorisés ;
Cette résilience est, en outre, une opportunité d’adaptation de la forêt au changement climatique. - lutte contre leur propagation grâce au travail d’entretien des diverses infrastructures par l’équipe gestionnaire (co-bénéfice) et à la politique engagée pour la mobilisation de la ressource en eau pour la défense du massif forestier contre l’incendie (zone d’écopage des canadairs sur le lac du Commanday en particulier). C’est à ce titre par exemple que l’économie réalisée, lors de l’incendie qui s’est déclaré en juillet 2022 à Vert, a été évaluée à 57 924 € (coût évité).
3- régulation de la qualité de l’eau
Les milieux naturels ont la capacité de filtrer différents polluants, améliorant ainsi la qualité des masses d’eau du site et celles des cours d’eau situés dans l’ensemble du bassin versant. 3 995 kg d’azote par an peuvent potentiellement être fixés. Les milieux qui contribuent le plus à ce service de régulation sont les roselières et les végétations rivulaires. La rétention annuelle des nitrates que peuvent filtrer les milieux de la réserve couterait environ 280 000 €/an si cette fonctionnalité était réalisée par une station d’épuration.
4 - bénéfices immatériels et expérientiels perçus par la population
La réserve propose des activités de sensibilisation à destination du grand public : visites guidées, évènements etc. ainsi que des activités d’éducation à destination des scolaires Elle accueille environ 161 000 visiteurs/an, dont plus de 25 000 qui passent par la Maison de Site (point d’accueil de la réserve). Près de 2 000 personnes bénéficient d’une activité de sensibilisation encadrée par l’équipe gestionnaire alors qu’en même temps ce sont plus de 1 100 élèves et encadrants qui sont accueillis sur site. Ces activités engendrent un consentement à payer des visiteurs de la réserve attribuable à l’envie d’apprendre et de se sensibiliser évalué à 36 736 € en 2024.
La réserve est accessible pour partie gratuitement pour le grand public via les sentiers de promenades et d’interprétation qui bordent le lac ou parcourent des espaces plus éloignés du lac (tour du Commanday, chênaies et boisements mixtes sur la frange nord-ouest et à l’ouest du lac). L’enquête conduite dans le cadre de l’étude de août à octobre a permis de déterminer les éléments qui ont motivé le déplacement de ces visiteurs pour se rendre sur le site. Le consentement à payer total minimal pour se rendre sur la réserve est évalué à 591 874 €/an.
Les services culturels les plus significatifs rendus par la réserve sont la possibilité de pratiquer des activités récréatives de plein air (39%), la perception émotionnelle du paysage ou aménités paysagères (35%), le bénéfice sur la santé mentale et le bien-être procuré (18%), l’envie d’apprendre et de découvrir (6%).
5 – production de biens écosystémiques
La réserve accueille peu d’activités économiques. Néanmoins, un agriculteur pratique une activité de fauche sur des prairies de la réserve et une apicultrice dispose de plusieurs ruchers.
La gestion des espaces forestiers de la réserve ou la lutte contre la fermeture des milieux par progression des ligneux permet de valoriser du bois prélevé dans le milieu, source d’autofinancement pour le gestionnaire.
Les biens produits par la réserve sont évalués 64 695 €/ an.
Ces services soulignent l’importance écologique et socio-économique de la réserve naturelle d’Arjuzanx, notamment en termes de santé publique, de lutte contre le changement climatique et de gestion durable de la ressource.
◆ Ancrage territorial (Indicateurs d'intégration et d'appropriation) ◆
Le diagnostic d’ancrage territorial (DAT) de la Réserve naturelle nationale d'Arjuzanx a été réalisée de mars à août 2023.
Ce diagnostic est basé sur une méthodologie élaborée par la LPO et Réserves Naturelles de France. Il évalue la perception et l’appropriation d’un espace naturel protégé par les acteurs socio-économiques locaux et les habitants. Le rôle et la place des Réserves naturelles sur leur territoire sont en effet liés aux représentations des acteurs locaux.
Le DAT vise ainsi à comprendre les freins et leviers au projet de protection.
Les conclusions du diagnostic seront traduites en objectifs d’amélioration dans le plan de gestion en cours de développement pour en améliorer la réussite.
Prenez le temps de les découvrir en consultant la synthèse en bas de page ou en parcourant le rapport d'étude disponible dans la rubrique "Documentation"